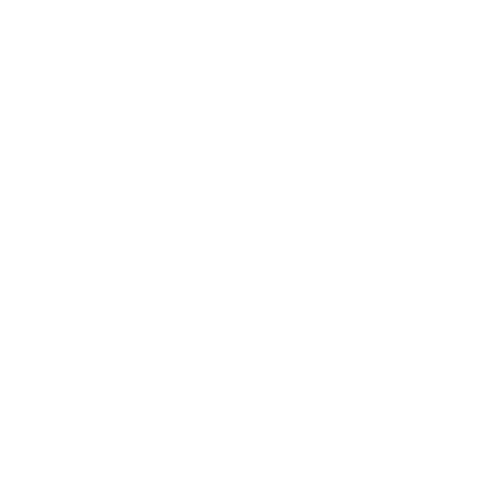Mathis Harpham
la braderie de l’âme
Tante Rouge
Une teinte rouge.
Je vis enfin seul. Personne d’autre que moi. Personne pour me faire chier.
Je rentre, j’ai travaillé aujourd’hui, j’ai avancé, j’ai sué, j’ai été inconfortable. J’ai mérité. Je sais que demain, j’ai pas à me lever, alors j’ai pas peur de faire des trucs jusqu’à tard dans la nuit, dans ma petite bulle de lumière cachée, pendant que le monde dort.
La bande lumineuse du mur de ma chambre-cuisine-salon est réglée sur le rouge. C’est ma couleur de lumière préférée, j’aime l’ambiance tamisée. J’ai envie de lire, envie d’être. Je suis jeune, alors ça ne m’inquiète pas de vivre dans une pièce, de gagner juste de quoi payer mon loyer, en fait, pas assez pour payer mon loyer. Ma période de dépendance financière envers ma mère tire à sa fin. Je fais durer mes économies comme on étalerait les restes d’un pot de confiture sur un toast trop grand. On racle, on racle, on fait durer, on étale, juste pour recouvrir la surface, on sait que ç’aura pas de goût, la couche de confiture est trop mince.
Je pense à ma tante de 78 ans à qui j’ai parlé hier sur WhatsApp et qui m’a dit qu’elle n’avait jamais arrêté de se sentir comme une ado. Ça m’a rappelé quand j’avais zoné un soir sur Redit. Je voulais savoir ce que ça faisait d’être vieux, je m’étais trop souvent posé la question. La plupart parlait avec une désarmante franchise de la désarmante simplicité du vieillissement. On reste soi, on ne change pas vraiment, mais le corps vieillit. C’est étrange, la sensation intérieure s’arrête à la post-adolescence, me dit ma tante, mais le corps, lui, vieillit avec une inertie increvable dès la naissance. Je m’imagine vieillard. J’espère que je n’aurai pas les mêmes envies qu’aujourd’hui, qu’au moins elles se seront taries un peu. Je ne veux pas devenir un vieux con. Un jeune con, ça va encore. Un vieux con, c’est insupportable, on devient le bouffon d’une chanson de Brassens. Ma tante est une ado coincée dans un corps de 78 ans. Elle regarde des vidéos de « vanlife ». Son mari est totalement dépendant d’elle et ses lamentations se rapprochent dangereusement du chantage au suicide lorsqu’elle veut voyager ou passer un peu de temps à l’extérieur de la maison. Il a choisi de s’emmurer jusqu’à ne plus vivre. C’est Antigone sans cause. Son cerveau est branché sur le même rythme, les mêmes gestes et la même télé depuis des années et maintenant, c’est un automate. Je ne veux pas être un automate, à m’ennuyer et à trouver le temps long tout en le voyant défiler à une allure effrayante.

Monsieur le cheval avec son gros croupion
Le paysage se teinte d’un jaune qui me fonce dessus, les couleurs perdent leur saturation et l’air se charge d’une fraicheur piquante. Je suis tout seul dans ma voiture, y’a personne sur la route, elle est large. Des deux côtés de mon sillage, des champs vides, incompréhensibles et incompréhensifs. De l’herbe haute, de l’espace. Au loin, ponctuellement, des bâtiments utilitaires carrés, fripés de tôles, dont la laideur est tempérée par le coucher du soleil.
Je suis en Gaspésie. Des chevaux broutent dans un de ces champs. Tout est calme. Je me vois garer la voiture sur le côté de la route graveleuse, descendre. Je ne ferme pas les portes à clé. Clac. Je marche en direction des chevaux, je trottine presque. Ils lèvent la tête, intrigués. Je me jette sur une des bêtes, je claque son gros croupion musculeux et ridicule. Je reçois un éclair de sabot dans la mâchoire, je perds connaissance instantanément. Ou alors, il me défonce la cage thoracique, dont les côtes viennent traitreusement me percer le poumon et d’autres organes vitaux, très vitaux. La douleur est paralysante, l’air expulsé ne rentre plus, tout est bloqué. Je chois, recroquevillé comme une boule de papier froissé qui se consume, je ne peux même pas gémir. Ma douleur est à moi et je ne la partage pas. Monsieur le cheval va brouter un peu plus loin, calmé par ma défection. Les autres se sont éloignés aussi. J’ai le visage dans l’herbe mais je ne sens plus rien, je suis une boule de douleur tordue. Ça traverse mon plexus, se rend jusqu’au milieu de moi, et remonte dans ma gorge. Je ne sais pas si je vomis ou si je m’étouffe avec du sang. De loin, on dirait que je prie, désespérément, avec une ardeur qui m’enfonce la tête dans la terre, je me soumets absolument et totalement à mon idole.
Tout est calme, les ombres s’allongent et je m’éteins lentement dans ce champ vide, absurde et inconnu. Quelque part, un grillon ambitieux prend les devants et amorce le chœur nuptial, en soliste.

Tu m’as sauvé ?
C’est quoi la génération d’hommes avant moi ? C’est quoi, c’est qui ? C’est qui ces mecs qui allaient sur les plateaux télé pour expliquer qu’ils préféraient baiser des mineur·e·s ? C’est qui les hommes et les femmes qui regardaient ces émissions et qui ricanaient ? C’est qui les mineur·e·s qui se faisaient trafiquer comme des objets sans âme dans les cercles adultes ? Vald, un rappeur qui a capté certains trucs : « orphelins violés désarticulés, les loisirs de la haute sont particuliers ». Ouais mec. Particuliers.
Mais peut-être que ça m’a sauvé. Peut-être que réagir, m’opposer, prendre acte, et parler, « moi aussi il me l’a fait », peut-être que ça m’a sauvé. Peut-être que la tache indélébile que je porte m’a forcé à renier le narcissisme insidieux du clan familial, elle était incompatible avec une image idéalisée de pureté et d’invulnérabilité. Une clé anglaise jetée dans les rouages bien huilés de la machine qui avait peu à peu remplacé ma chair. En fait, mon ultime acte de rébellion envers mes parents, qui m’avaient forcé à me tuer et à jouer le parfait garçon pour qu’ils me lâchent quelques miettes d’affection que je gobais sous la table, c’est de reconnaitre cet acte et d’en parler. C’est un énorme doigt d’honneur à ma vision propre et aseptisée de moi-même. C’est une force de vie, de prendre tout ce qu’on a vécu et de le faire sien. On l’a pas mérité. On a mérité autre chose. On peut pleurer. Mais au moins on est vivant, vraiment vivant, dans notre humanité. Grâce à Willie, le pédophile, moniteur de colonie de vacances, sympa et séduisant, grâce à son acte infâme, j’ai eu une munition, une balle en argent, pour abattre le loup-garou de mon enfance sombre et factice, pour briser un miroir dont je confondais l’image avec mon moi.
Je la porte autour de mon cou, cette balle, un jour elle me servira.

D’après un article du Monde
Elle a vu un jeune homme courir, il perdait tellement de sang qu’elle a cru qu’il portait un pantalon rouge alors qu’il était en short. Lynché et poursuivi par une vingtaine de jeunes enragés, il est aujourd’hui amputé sous le genou droit. Qu’est ce qui habite un garçon de 17 ans pour qu’il perfore la joue d’un autre avec un couteau avant de se joindre à un tabassage orgiaque dont s’est échappée la victime par pur miracle ? Il n’osait pas tout à fait l’égorger, comme ça, proprement, tout de suite. Si le salaud mourait, ça serait un effort de groupe, ça serait donc la faute de tout le monde et personne en même temps. Le meurtre est dilué, indéfini, le traître est mort de ses blessures, et non d’une volonté individuelle. Ces scènes hantent mes songes. L’existence d’une telle violence, gratuite, injuste, la possibilité, le potentiel que portent en eux les êtres humains dont le cœur s’est vidé d’empathie, pour ne devenir qu’esclaves des lois arbitraires de leur clan, me dérangent dans mon existence.
Work Hard Lunch Hard, sur un sac qu’elle berce près d’elle. J’ai chaud dans ce wagon.

Tu l’aperçois, d’abord une petite silhouette au loin. Il attend. Il t’attend, sur le bord de la route brune. Il est assez emmitouflé, y’a juste son visage qui dépasse. Mais tu comprends son regard, qui est dans son corps, son attitude. Ses yeux sont ridés sur les côtés à force de sourire. On appelle ça des pattes de corbeaux ou un truc comme ça. Sa peau est usée. Il t’a jamais oublié, lui. Tu arrives à son niveau, il a un gros sac, un gros sac de voyage. Il est content que tu sois là, ses yeux se plissent. Le silence du paysage embrumé prend une profondeur nouvelle. Enfin. Sa peau brune, mat, son étincelle dans l’œil. Il t’attendait.
On y va.