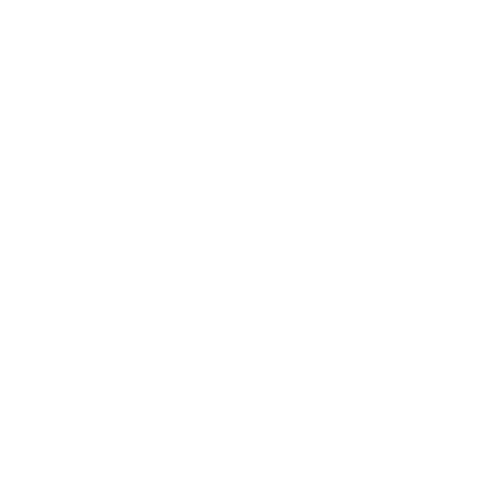Sarah Bouhouita-Guermech
Détentrice d’un Baccalauréat en neurosciences de la faculté de médecine de l’Université de Montréal.
L’architecture : un remède?
Entre quatre murs. Je suis du regard le trot de l’aiguille de l’horloge. Ses mouvements saccadés donnent l’impression que le temps peut se figer d’une seconde à l’autre. La lumière jaunâtre de la salle joue avec ma vision et je rentre petit à petit dans un trou noir au milieu d’astres filants qui m’emportent vers un nimbus multicolore. Une silhouette surgit au-dessus de l’accumulation condensée de couleurs. Elle émet tantôt des sons, tantôt des murmures, tantôt des rugissements. Je tente d’interpréter les appels d’un interlocuteur qui m’est toujours étranger. Les bruits se font de plus en plus fort à mesure que je m’approche de la créature nébuleuse. On m’appelle par mon nom. Je sursaute et je reviens à la réalité. Mon enseignante m’enjoint à regarder le tableau. J’acquiesce d’un hochement de tête et mon regard survole les chiffres et les lettres dansantes avant de se river à l’horloge de nouveau. Quatre minutes interminables sont passées. Seulement quatre. Je deviens claustrophobe. Les fenêtres rétrécissent et les murs se referment sur moi. Je frotte mes mains sur mes cuisses avec l’espoir que mes pantalons puissent absorber le déluge qui s’en écoule. La cloche sonne, enfin. Je m’empresse de prendre mes livres et je marche hâtivement vers la porte. Je marche dans les couloirs étroits et lugubres de l’école, prenant garde de ne pas entrer en collision avec les autres. Le manque d’aération de l’établissement me fait tousser jusqu’à ce que des larmes me montent aux yeux. Je trouve mon casier et je m’empresse d’ouvrir mon cadenas pour pouvoir enfin décamper. Je fais glisser la fermeture éclair de mon manteau tout en marchant d’un pas rapide vers les escaliers. Je dois à tout prix sortir. La cause n’est pas gagnée tant et aussi longtemps que je n’ai pas mis les pieds à l’extérieur. L’air sec de l’intérieur entraîne mes poumons à se rétracter deux fois plus rapidement ; je crains manquer d’oxygène. Arrivée au pied de l’escalier, je reprends mon souffle. Le temps se fige à nouveau, les bruits se dissipent et se transforment en échos ralentis. Pas une seconde de plus avant que je m’élance vers les portes de ma délivrance.
Mes yeux prennent quelques secondes à s’ajuster. Le contraste entre la lumière éblouissante et l’intérieur de l’édifice me rappelle qu’il fait encore jour. Je me sens tout de suite réconfortée par les rayons du soleil. Mon visage se relâche et mes ridules, formées par le froncement soutenu de mes sourcils tout au long de la journée, s’affaissent enfin. Le vent qui effleure ma peau me revigore. Un sentiment de quiétude s’installe.
Arrivée chez moi, je laisse glisser mon sac par terre et je me pose sur mon lit, mon carnet de dessins en main. Je reprends l’esquisse laissée de côté et retravaille les fenêtres de mon immeuble en construction. J’efface les bordures du haut et j’allonge les côtés afin de laisser paraître la vue extérieure dans toute sa splendeur. Les fenêtres sont des portails permettant de relier le monde intérieur au monde extérieur. Je m’assure de les élargir afin que les habitants de l’immeuble n’aient jamais la sensation d’être emprisonnés, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.
Je redessine la ville que j’aperçois par la fenêtre. Au lieu d’un gratte-ciel aux cent étages qui transperce le ciel, je conçois un immeuble avec du caractère qui égayerait davantage la ville. À ma droite, des déchets toxiques volatils propulsés par une usine pénètrent dans les nuages, assombrissant le ciel et le rendant maussade. Pour remplacer cette vue, je mets au point un bâtiment dont le toit abrite une végétation qui recycle l’air et où poussent des fruits et des légumes biologiques qui servent à nourrir les habitants de la ville. Affichées dans ma tête les mille et une possibilités de reconstruction de cette ville, je m’apprête à prendre une photo imaginaire de ce que je vois. Et clic. Un jour.
***
Comme disait Antoine de Saint-Exupéry, « fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité ». Plus facile à dire qu’à faire. Me voilà forcée de baisser mes manches pour cacher mes doigts meurtris d’ampoules. Depuis l’obtention de mon diplôme de baccalauréat, il n’y a pas une journée qui passe sans que je dessine. Il y a des journées stimulantes, d’autres plus frustrantes, et certaines plutôt contemplatives. J’aimerais accélérer le temps et arriver déjà aux meilleurs moments de ma carrière, mais je me retrouve à courir après lui.
Je commence à feuilleter une revue. Je tombe sur l’image d’un enfant arborant un grand sourire devant une maison colorée. Voilà l’effet que j’aimerais provoquer. Cela peut paraître étrange de penser que ma passion pourrait aider les gens ou encore les rendre heureux, mais j’ose espérer que chacun d’entre nous puisse apporter sa contribution dans le monde. Je dépose la revue et je me prépare à sortir.
Aujourd’hui, j’ai prévu d’assister à une conférence sur l’histoire de l’architecture animée par la directrice du programme. Cela me donnera l’occasion de mettre le nez dehors pour la première fois depuis trois jours. J’ai été ensevelie sous les feuilles, dans mon appartement, pendant trop longtemps. Un changement de scène ne me fera pas de mal.
Sur mon chemin, j’aperçois une bâtisse magnifique. Par réflexe, je sors mon appareil photo de mon sac messager et commence à inspecter ce à quoi je fais face.
Les colonnes romaines ont une allure imposante, non pas qu’elles aient une quelconque utilité, mais on dirait que, sans elles, tout s’effondrerait. L’aspect majestueux du monument complète bien les traits fins et soignés qui y ont été tracés. La complexité des détails confère à l’ensemble un caractère harmonieux. Plus je m’approche, plus j’arrive à décortiquer ses parties. La façade semble exhiber les dizaines d’années qui ont été nécessaires à la construction du monument et les centaines d’années au cours desquelles il est demeuré au sol, fixe, face aux changements multiples de la cité qui l’entoure. Si les édifices étaient vivants, ils nous raconteraient les multitudes de péripéties qui se sont produites aux alentours et à l’intérieur d’eux. Ils nous diraient que l’histoire se répète. On dit que les murs ont des oreilles, mais si seulement ils pouvaient nous transmettre leurs connaissances, leur vécu, toutes les histoires qu’ils ont absorbées au fil du temps. Je recule, recentre la caméra et… clic.
Après quelques photos des différents angles, je décide qu’il est temps de rebrousser chemin avant que le temps me rattrape.
J’entre dans un amphithéâtre majestueux, dont la moitié des sièges sont occupés. Je trouve le mien et m’assois. La salle se remplit peu à peu. Quelque temps après, les lumières s’éteignent et l’intervenante fait son apparition.
Pour créer, il est essentiel d’observer son monde. De décortiquer ce qui nous compose. De comprendre notre entourage. D’écouter la nature qui se transforme continuellement. De s’en inspirer pour innover, explique la directrice.
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme[1]. » La formule de Lavoisier ne s’appliquerait pas seulement en chimie mais bien à tout ce qui fait partie de notre quotidien.
La directrice nous montre ensuite des images nous permettant de visualiser des structures architecturales d’époques variées et distinctes.
Les premières images nous transportent au milieu de l’Empire romain. Les monuments splendides de cette époque font partie intégrante de la révolution architecturale.
Ensuite, nous aboutissons à l’Empire ottoman. D’autres merveilleuses structures architecturales y ont été établies. La salle exprime son admiration pour les calligraphies utilisées sur les édifices. La manière dont cette architecture a eu la capacité d’arrimer les différentes influences artistiques est exceptionnelle.
Plusieurs innovations d’aujourd’hui ont fleuri grâce à des individus d’autrefois. Peu importe nos différences, le pinceau nous a été tendu et c’est à notre tour de continuer à peindre notre monde.
La conférence terminée, je sors de l’amphithéâtre. Ma vision devient floue à cause de la pluie battante. J’ai oublié mon parapluie, je m’élance vers l’arrêt de bus.
En arrivant chez moi, je me laisse tomber sur mon lit, bien consciente que mes draps seront trempés. Après un moment d’absence, je rouvre les yeux et je fixe le plafond. Toutes les diapositives que j’ai vues aujourd’hui apparaissent au-dessus de moi comme si un projecteur les diffusait. L’inspiration vient de partout, mais je n’arrive tout de même pas à rassembler mes idées pour avancer. Est-ce moi qui me cause mes propres maux ? Les choses ont l’air à la fois simples et complexes. Plusieurs architectes sont arrivés avant moi et plusieurs viendront après. Comment pourrais-je marquer ma propre histoire ? Où est partie l’enfant d’autrefois qui était plein d’espoir et croyait qu’il suffisait d’avoir près de soi son carnet et son crayon pour dessiner son avenir et soigner son monde ? Je m’affole. Je fais peut-être une crise d’angoisse. Cela ne m’est pas arrivé depuis des années. Mais qu’est-ce qui se passe ? Je ferme les yeux, je prends une grande respiration et je me recentre. Oui, bien des personnes sont arrivées avant moi et bien d’autres me succèderont. Pourquoi ne serais-je pas capable d’exploits aussi impressionnants que ceux qui ont été accomplis auparavant ? J’ai beaucoup à apprendre, mais j’ai aussi beaucoup à offrir. Le règne des empires est éphémère, mais leur marque reste gravée dans l’histoire.
Après une douche chaude, je mets des vêtements secs et me redresse devant mon bureau. Je reprends l’esquisse que j’ai laissée de côté. Je continue l’histoire.
[1] Loi de Lavoisier