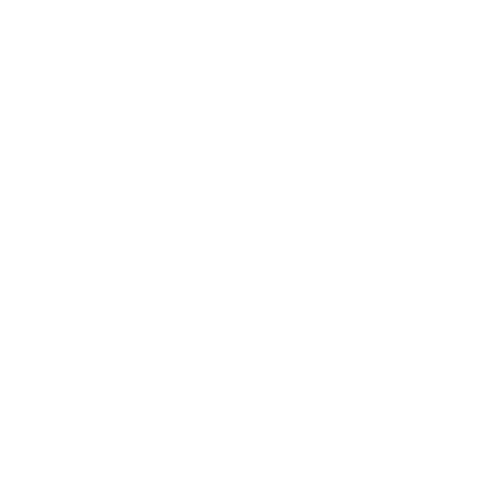Madeleine Savart
Formée en littérature française et en histoire de la philosophie, Madeleine Savart réfléchit aux enjeux littéraires, philosophiques et socio-politiques dans les débats sur la langue au XVIIe siècle.
Les abeilles
Allô ma chérie ? […]
Comment vas-tu ? […]
Alors, qu’as-tu décidé finalement ? […]
Oui, ça semble une très bonne idée, effectivement, oui. Et puis, c’est plus raisonnable si tu veux espérer profiter de ce temps pour travailler, oui. […]
Ah ça, pour être tranquille, tu seras tranquille ! Personne pour t’embêter ou te déconcentrer. […]
Est-ce que tu sais quel jour tu penses arriver ?
Je suis arrivée.
Depuis, chaque matin, je trouve des abeilles au rez-de-chaussée. Elles se traînent sur le carrelage blanc ou volent contre les petits carreaux de la fenêtre fermée. Je ne sais jamais combien il y en aura : parfois deux ou trois, parfois presque une vingtaine. À peine sortie de ma chambre, je descends lentement chaque marche en observant l’intérieur de la pièce ensoleillée.
Lentement, pour localiser les petits corps, pour prévoir mes gestes. Le bois de l’escalier craque, m’oblige à ralentir pour prévenir le bruit. Même si j’habite seule la maison. J’analyse ce que je vois, essayant de ne pas me demander pourquoi, sans laisser l’immense poids envahir ma poitrine.
Ouvrir la fenêtre, libérer celles qui sont coincées entre les vitres et le mur, déplacer celles qui errent sur le rebord intérieur de la fenêtre, sur la pierre du seuil extérieur. Préparer de l’eau sucrée, en déposer quelques gouttes près des abeilles trop faibles pour voler, séparer celles qui s’attaquent mutuellement. Prendre un papier un peu rigide pour ramasser celles qui gisent au sol ou encore dans les cendres du foyer : certaines sont mortes, d’autres ne bougent plus que leurs antennes, d’autres s’accrochent avec difficulté à la tranche du papier cartonné, d’autres essayent de voler sur quelques centimètres. Un courant de corps en peine sans fin.
Je fais des relevés et je prends note de leur nombre, de leur vigueur, de la présence de cendres ou de cire. Je consigne avec de trop nombreux x celles que j’ai retournées à la poussière du feu, celles qui sont reparties dehors. Les fleurs du rosier grimpant n’ont pas encore disparu malgré la saison, mais les quelques abeilles qui s’envolent filent directement vers le ciel. Le temps qui s’étire semble compté. J’essaie d’adoucir la souffrance, mais ce rôle me semble si loin de moi.
J’ai appris sur Internet la différence entre hiberner et hiverner. Pas d’état léthargique profond, pas de baisse de la température corporelle chez les abeilles – elles en mourraient. Elles se barricadent et gigotent pendant des mois pour se réchauffer. C’est très précis : une sorte d’amas autour de la reine ; à l’extérieur du cercle, tournées vers le centre, elles soulèvent les ailes à un angle de 45°, celles qui sont à l’intérieur contractent les muscles de leurs ailes sans les bouger. Une sorte de formation militaire de type tortue, très précise, mais dure à se représenter, en train de faire un exercice quasi statique de renforcement des pectoraux. Mais dans cette maison, personne n’hiverne.
Chaque jour, je fais du thé, j’allume l’ordinateur, j’ouvre mes documents en cours de rédaction, le back-office d’un site en montage. Mes pauses épousent la fréquence de mes songeries intempestives. Quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour, je passe la tête dans la cheminée. L’âtre est tellement grand qu’on y tient debout et qu’il est facile de voir le ciel à travers le conduit. Dans le rectangle clair bourdonnent des abeilles. Une étreinte diffuse m’entraîne à vérifier qu’elles sont encore là. Je ne comprends pas pourquoi les abeilles perdent leur chemin. Je ne suis pas parvenue à déterminer si utiliser la cheminée influait ou non sur cette déroute. Mon père m’assure que si ça les enfumait, elles seraient parties depuis longtemps, que c’est même une technique d’apiculteur pour déloger des nids dans des combles ou sous des toitures. Le bois noueux des aulnes n’est pas bien sec, il siffle et il chante quand il brûle avec de grandes flammes. Les bûches de frênes durent plus longtemps, m’assurent de longues soirées méditatives, à ressasser mon incapacité criante à dénouer la situation. Je continue à allumer des feux pour ne pas avoir froid. Sans savoir si me chauffer désoriente davantage les abeilles. Les causes semblent invisibles. J’éteins mon téléphone. Je coupe par intermittence mon wifi, pas celui de ma grand-mère qui vit dans la maison d’à côté ; c’est le seul lien du hameau avec l’extérieur.
Si les gestes sont circonscrits, le qui-vive est constant. Je guette, sursaute au plus petit son sur les carreaux de la fenêtre, au moindre bourdonnement dans la pièce. L’accalmie du soir me laisse absorbée dans la contemplation du feu. Je ressasse des bribes des émissions de radio écoutées plus tôt.
Ces admirables hyménoptères sont présents sur Terre depuis au moins 45 millions d’années, soit bien plus longtemps que nous.
Certains zoologues les considèrent comme le premier animal domestiqué.
C’est le deuxième animal le plus étudié par Aristote après l’homme.
Elles pratiquent l’apprentissage social sans qu’on sache si elles en ont conscience, nourrissent des fantasmes gestionnaires, du matriarcat collectiviste au marché libéral.
Le miel ne pourrit jamais, Alexandre le Grand avait demandé à en être recouvert dans un cercueil en or.
Le corps d’Agésilos, roi de Sparte, y a été conservé pour être rapporté et inhumé en terre grecque.
Elles sont capables de modifier l’angle de leur danse par rapport au soleil pour en suivre le mouvement et adapter l’information selon l’heure de la journée.
Internet m’offre pléthores de chorégraphies en forme de huit réalisées avec moult frétillements de l’abdomen, mais la traduction n’est jamais proposée.
L’érudition ne répond pas aux interrogations ineffables qui bruissent pourtant avec insistance – un orage dans le crâne d’un sourd.
« Pourquoi ne tentent-elles pas de monter dans la cheminée ? Pourquoi ne retrouvent-elles pas la sortie du foyer, toujours ouverte ? Se disent-elles quelque chose quand elles s’épuisent sur le sol ou les carreaux ? » demandé-je aux braises. Je reste entourée des crépitements du feu, sans prise sur leurs manifestations. Sont-ce des indices, des icônes, des signes ? Quels étaient les éléments des pidgins transespèces observés par E. Kohn dans la forêt amazonienne ? Depuis combien de temps le nid était-il là ? Combien de générations viendront encore habiter la maison avant qu’aucune abeille ne butine plus dans le pays ? Ici, nous coexistons sans communiquer, dans une inquiétude ininterrompue. Je me sens « trop humain[e] », imperméable aux autres stratégies de communication. Je ne vois que des bribes, perçois seulement un flot impénétrable.
Je suis face à une désorientation qui me paralyse, face à l’expression d’une confusion dans un langage que je ne comprends pas. J’anticipe en cherchant le corps pourrissant d’où l’essaim ressuscitera, tout en me sachant incapable de sacrifice.
Le calme tendre de la maison paraît étirer le temps, étendre les plages de rituels et de repos. En contemplant le feu, je me demande si c’est pour le rallumer que je me lève tous les matins, pour les abeilles ou pour autre chose. Je sors des abeilles au-dehors sans savoir si un évènement viendra interrompre cette lente hécatombe. C’est finalement mon départ qui met fin à ces gestes de célébration improvisés, de deuil informulé, que je sais porteurs de nouvelles possibilités de résistance.