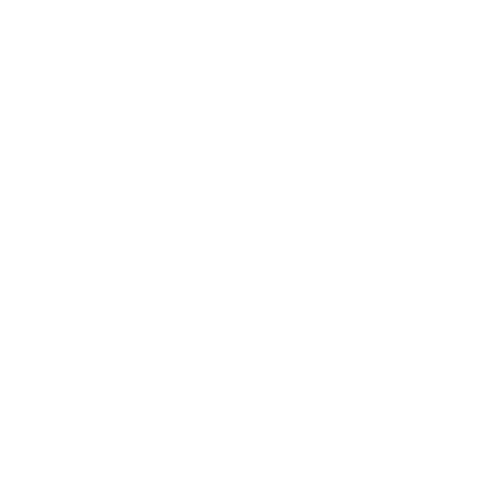Lucie Palombi
Architecte et candidate au doctorat
La visite
Depuis la cour, j’observe les corbeaux. Perchés sur le toit, ils me semblent inoffensifs. Leurs cris, vaguement plaintifs, se noient désormais dans la ouate veloutée du ciel blanc. Les lichens grignotent l’ardoise par endroits. En vingt ans, la maison n’a pas dû en voir beaucoup, de drôles d’oiseaux. Il fut un temps, où je foulais ces pavés, avant que la mousse ne les recouvre. Je revois mes genoux côtelés de velours qui baignent dans une flaque terreuse, au pied d’une chaise en plastique. Je joue dans la cour. De mes yeux embués, je sonde prudemment les environs. Je crains que quelqu’un – qui sais-je ? – ne me vole mon trésor. Mon corps d’adulte se promène aujourd’hui dans les ruines de ce souvenir lointain. Pour retrouver la mémoire, il suffit d’arracher le lierre de la porte d’entrée, de gratter les fientes qui scellent le verrou de la cuisine. Alors nous y sommes.
Le carrelage en damier semble intact. Un tapis de poussière le préserve. La végétation s’invite doucement par la fenêtre brisée. Quelques tiges enserrent les tuyaux du chauffage. Des particules sont suspendues dans une lumière diffuse. Les armoires en formica ont perdu leurs couleurs. Le soleil a taché le comptoir plastifié. La table et les chaises en pin n’ont pas bougé. Je revois la silhouette de grand-mère, en visite à la maison. Elle s’affaire, près de l’évier, à la préparation d’un jus d’oranges pressées. Son pendentif doré oscille lentement, alors qu’elle m’apporte un napperon et quelques biscuits. Elle me dit : « Allez, trouve ta place ». C’est chose faite, il me semble, à deux décennies et cinq-mille-trois-cent-quatre-vingts kilomètres de là. Après avoir vainement cherché à combler mes failles au mortier d’un amour transatlantique, dilué mon amertume dans du sirop d’érable, je suis devenue l’heureuse étrangère. Quand j’ai voulu retrouver ma grand-mère, il était déjà trop tard. À ce moment-là, tout fichait le camp, mais son conseil est resté dans un coin de ma tête. J’aperçois les trois marches qui mènent à la véranda.
Les joints des pavés de verre sont craquelés. Quelques tubes de gouache séchée me rappellent que j’avais ici l’habitude de peindre. Je trempais le pinceau dans l’eau et la couleur tour à tour. Le lavis infusait lentement. Il contaminait sans gêne la transparence du verre. Le papier trop fin ne résistait pas à mes tentatives. Tantôt l’eau ruisselait le long de la feuille pour rejoindre la toile cirée. Tantôt elle consentait à s’y fondre en une auréole dissidente. À cette époque, je guettais encore le retour de mon père après le travail. J’attendais que son ombre se dessine sur le mur, au moment où il passait dans la rue. Je ne me doutais pas que je quitterais mon pays natal, comme il l’avait fait des années avant moi. Désormais, c’est dans un atelier, auprès d’autres expatriés, que je dessine sur des pierres. Le crayon glisse sur leur peau calcaire, qui absorbe mes souvenirs. Je les y engramme – le lithographe le sait, les pierres ont bonne mémoire. Elles n’ont rien oublié. Ni de leur genèse, il y a des milliards d’années, au creux d’un massif feuilleté. Ni de leur extraction par les hommes de carrière, ou de leur traversée de l’océan, il y a deux siècles de cela. Nous nous consolons les unes les autres, quand des fantômes tenaces remontent à la surface, quand le froid mordille nos pores. Je sors de la pièce et rejoins les escaliers où un autre fragment de passé m’attend.
Je me revois grimper le colimaçon dans une sorte de danse molle. La pointe de mes pieds épouse la lourdeur pourpre du tapis qui recouvre les marches. Aujourd’hui il tombe en lambeaux. Ma main glisse sur le bois verni de la rampe. Les marches craquent. Sur la fenêtre embuée, un cactus sceptique déploie son reflet trouble. Des perles tracent leur sillon sur le verre dépoli. L’air est chargé d’odeurs et d’oiseaux. Maintenant les corbeaux se taisent, mais cette poussière molletonnée, je la respire encore. Je la retrouve le soir, dans Villeray, quand je regagne les hauteurs du triplex où je vis désormais. Il faut gravir deux escaliers pour accéder au nid. Le premier est vertigineux, glissant – sa rampe glacée. Le second est accueillant, doux – le tapis gris encaisse mes pas hâtifs. Perché sur un fauteuil, regard braqué sur la rue, le chat monte la garde depuis l’intérieur. Écureuils, moineaux et passereaux sont autant d’intrus que ses yeux couleur sauge détectent en moins d’une seconde. Au sommet de l’hélice de la vieille maison, pas de vigie, mais une pièce qui tend à s’éclaircir. Les bribes érodées du souvenir reviennent.
J’ignore quelle force me sort d’une torpeur réparatrice lors de cette sieste de fin d’après-midi. Je suis dans un état cotonneux. De nouveau, me voici dans cette chambre. Par les volets entrouverts, j’observe le quartier, depuis le deuxième étage. La rue David d’Angers est calme. L’Oudon s’écoule comme de l’huile. Je dépose un petit oiseau en bois sculpté sur le bord de la fenêtre. De la cour à la cuisine, de la cuisine à la véranda, de la véranda aux escaliers, des escaliers à la chambre : après plus de vingt ans, c’est dans l’exil que j’ai retrouvé ma place. « Rrok-rrok », « kraaa-kraaa », « toc-toc-toc ». Il y a deux semaines, rue Saint-Denis, deux corbeaux se sont posés sur le toit de ma maison.
Le vol
La rue est calme, le temps maussade. Sous la pluie, les corbeaux croassent. « Rrok-rrok », « kraaa-kraaa », « toc-toc-toc » : chacun redouble de vocalises, de sifflements d’ailes et de claquements de bec pour signifier sa présence. À travers les volets ajourés du deuxième étage, une petite forme se détache des draps. Dans la rue, une voiture jaillit à toute allure. Sur l’asphalte, un tapis de gaz d’échappement. Le conducteur, visiblement impatient, gare à la hâte le véhicule suintant. Deux roues mordent le trottoir pavé. La fumée se dissipe. Une vigie, perchée sur l’antenne du toit, signale l’intrus d’un râle rugueux. La petite forme se poste derrière la vitre embuée de la cage d’escalier.
Des perles tracent leur sillon sur le verre. Elles présentent leurs derniers hommages à ce qui ressemble à une plante mourante – un de ces végétaux antipathiques gardés bien au chaud et qui, déployant leurs piques, refusent l’asile aux compagnons ailés. L’averse s’est arrêtée. La petite silhouette poursuit sa descente sans un bruit. Elle coule mollement dans les marches, se dissout lentement dans le colimaçon – elle a changé de pièce. Derrière les briques de verre, ses contours se dessinent touche par touche, à la manière d’un tableau impressionniste. Installée à une table, plongée dans ses activités, elle ne voit pas l’eau qui, dehors, s’échappe à la hâte dans le caniveau. La pluie, froissée par sa chute, évolue désormais en un ru chagrin.
La course de ses larmes est coupée par les pas tranchants d’un homme – il est déjà sorti de la voiture. Les gardes s’affairent davantage, ébrouent le bleu nuit de leur torse duveté, battent des ailes. Tout à coup, leurs cris se font stridents. L’individu ne semble même pas les remarquer – à moins qu’il choisisse de les ignorer. Les corbeaux se consultent du regard et, démunis, baissent les ailes. Alors que l’homme longe la fenêtre de la véranda, la petite silhouette s’enfuit soudainement – sans doute a-t-elle pris peur. La lumière s’éteint – elle rejoint le cœur rassurant de la maison.
Depuis la cour, par la fenêtre en bois, la vue sur la cuisine est dégagée. Une femme en tablier rouge sort un biscuit appétissant et le pose sur la table. Le pendentif doré, suspendu à son cou, étincelle. Le petit corps est de retour – il investit les lieux à pas de loup. La femme l’interroge silencieusement. Elle s’éclipse à son tour quelques secondes. Lorsqu’elle réapparaît, c’est pour lui apporter quelque chose. Elle s’absorbe ensuite dans ses tâches.
Voici le petit corps – c’est une fillette ! – qui sort dans le dehors pavé de la cour. Elle porte un manteau en duvet et des souliers bleus. Elle tire, discrètement, un minuscule objet de sa poche, puis le tient avec plus de force que nécessaire dans ses petites mains moites. Depuis le toit d’ardoise, encerclée par quatre murs élancés, la fillette joue sur le sol trempé. Une mare de crasse dégouline de l’assise d’une chaise en plastique. Elle exsude sur ses pieds. Ses genoux côtelés de velours s’imbibent d’eau. Inquiète, l’enfant fait un tour sur elle-même. Son regard sonde prudemment les environs. Une fois rassurée, elle révèle sur ses paumes glacées un oiseau sculpté dans du bois. Elle le trempe sans gêne dans la flaque terreuse.
La peinture qui dessine ses yeux délavés semble se dissoudre un peu plus encore. « Rrok-rrok » : quelque chose se passe, au loin. Un danger la guette. Elle en est avertie. Elle sursaute, dissimule son butin et scrute la cour à son niveau, comme si elle se sentait épiée. Ne voyant rien venir, elle expose de nouveau, du bout des doigts, la précieuse statuette. C’est ce moment précis que choisit une sombre silhouette pour apparaître devant elle. Furtive, son ombre suspend le temps et l’espace. Et puis, plus rien ! L’enfant peut à peine en prendre conscience : en moins d’une seconde, son trésor lui a été arraché des mains. Son cri déchire le voile du ciel. Le fugitif, évaporé, ne laisse sur la scène du délit qu’une petite plume d’un noir bleuté.