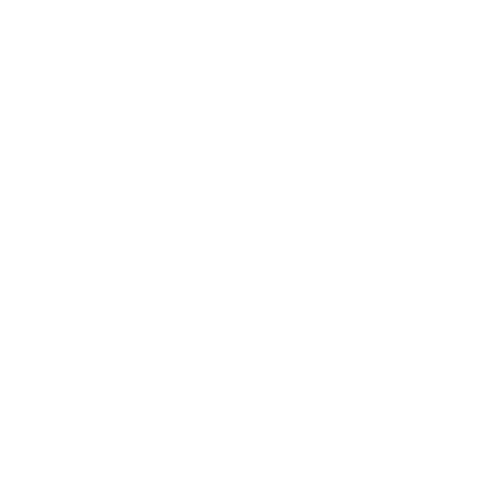Laurence Laneuville
Résidente en psychiatrie et étudiante à la maîtrise en recherche-création
Arrêts sur image
Mardi 27 septembre 2011
Montréal
Je suis assise à mon bureau. Le coucher de soleil donne à la mélamine brune des reflets irisés. Le ciel explose de nuances orangées alors que les derniers rayons disparaissent derrière l’Hôpital Sainte-Justine. J’entends la musique de Bach. Ses notes, telle une complainte, me parviennent à travers ma radio crépitante. C’est la fin de l’été, la session d’automne vient de débuter. Le feuillage des quelques arbres plantés sur le terrain du collège se colore lui aussi de touches orange comme mes mains qui conservent un teint basané sous la lumière. Mon sac repose à mes côtés, sur le lit. Quelques manuels dépassent de sa gueule béante. Je n’ai pas envie de les ouvrir.
Je sors mon téléphone cellulaire de ma poche, un BLACKBERRY CURVE 9330 noir dont je suis plutôt fière. Posséder un premier téléphone cellulaire, pouvoir joindre mes amis à tout moment à l’insu de mes parents, gagner cette indépendance me font éprouver un sentiment d’accomplissement. J’effleure le clavier de mes doigts. Les touches sont minuscules, mais fermes. Je presse le bouton d’accueil. L’écran de veille s’efface : aucun nouveau message.
J’ai comme un vide dans l’estomac.
Dehors, des étudiants sortent par petits groupes par les grandes portes du collège. J’en reconnais quelques-uns. Je ne sais pas ce que font mes amis à cette heure. Olive est peut-être allée au gym, sans m’inviter. Clara est sûrement rentrée chez elle. Ce soir il y a un match d’impro, j’ai vu les affiches dans la grande salle, mais je n’oserais pas y aller seule. Tout le monde est occupé, j’hésite à texter quelqu’un. J’ai la flemme, quelque chose comme un vague à l’âme. Dans mon cours de littérature, M. Popescu parlait ce matin du mal du siècle et des romantiques. Je me demande si nous ne souffrons pas du même mal, mais dans un autre siècle. Je voudrais qu’on m’invite à sortir.
À ce moment, je ferme les yeux, je fais le souhait de fuir cet endroit.
Mercredi 11 octobre 2006
McMasterville
Je suis debout, mon sac à dos à roulettes à mes pieds. La fin des classes a sonné, on a rempli prestement notre sac de livres pour la soirée, après avoir consulté l’agenda. Devoir d’histoire pour demain, il faut commencer le laboratoire de chimie pour la semaine prochaine. On s’est attendu devant les casiers, on s’est raconté notre journée. Jordan s’est fait sortir de classe, encore. On m’a mise en équipe avec Alec pour la présentation d’anglais. C’est chien, il est vraiment poche.
On a traîné notre sac et notre boîte à lunch dans le stationnement. Une bonne demi-douzaine d’autobus jaunes s’alignent déjà devant nous, moteurs éteints. On a quelques minutes pour jaser avant qu’il soit temps d’y monter. Depuis trois semaines, Sarah sort avec Loïc, l’ami de Jordan. Sarah est super belle, elle plaît naturellement aux garçons. Je l’envie. Je suis plutôt invisible à leurs yeux. Sarah, elle, elle est normale. Elle m’invite à un party d’Halloween chez elle, dans deux semaines. Il faudra se déguiser. Je n’ai jamais rien trouvé de mieux que de me déguiser en cow-boy. J’ai l’impression que j’aurais l’air trop ridicule vêtue autrement.
On s’enlace et on se sépare jusqu’au lendemain. Je monte à bord du 306. Je me retrouve sur le banc au-dessus de la roue arrière, ceux du fond sont tous pris. Je dois me recroqueviller en hissant mes jambes sur la coque de la roue. La banquette de vinyle au rembourrage mince rejette durement mon corps. J’appuie ma tête contre la fenêtre. Les autobus un à un se mettent en route, quittent le stationnement. Cinquante mètres carrés d’asphalte abandonné. Chacun se dirige quelque part, je ne sais où. Soudainement, ça me semble évident, quelque chose se passe ailleurs, sans moi.
Jeudi 2 décembre 2021
Montréal
Des lettres surgissent sur l’écran à mesure que je les tape sur le clavier. Tout est calme autour de moi, la matinée est plutôt douce. La première neige est tombée durant la nuit. Cette neige délicate qui recouvre le sol a purifié le décor, tout a blanchi. Le bureau sur lequel je travaille, celui qui me suit depuis l’adolescence, est lui aussi passé au blanc. J’ai effacé plusieurs souvenirs en camouflant minutieusement chaque égratignure sous la peinture, en remplaçant les poignées des tiroirs. C’est pareil pour moi. Lors de nouvelles rencontres, je me montre maintenant rayonnante, toute neuve devant les autres, je serre les mains et je fais la bise en souriant. J’ai changé plusieurs fois de cellulaire et vécu de nombreux partys d’Halloween. Mon sac à dos a perdu ses roulettes depuis longtemps.
Hier, le vide qui m’accablait me donne aujourd’hui la liberté d’inventer. Alchimiste du rien, je fabrique une substance à partir de l’absence, du manque. Les jours révolus m’offrent un canevas : je bâtis un royaume avec des fantômes.
Ainsi, les histoires de mon passé s’érigent et se révèlent sous une lumière différente. Elles ont un goût sucré et amer à la fois. Mais sur la page, je sens que chaque élément prend place naturellement, les regrets comme les couchers de soleil que j’ai ratés. Enfin tout me semble avoir eu lieu d’être ; une plénitude m’habite.
J’écris. En trame de fond, la suite de violoncelle numéro un en sol majeur de Bach me revient à l’esprit. La suite me parle d’une aventure en contrepoint, d’un écrasement en staccato puis d’un nouveau départ en vrille, glissement exalté et bouleversant qui traîne longtemps, longtemps en tête. C’est la naissance et la floraison contenues en quelques mesures, tout ce qu’il aura été nécessaire de dire, la mélancolie, la joie, la douleur, tout cela à la fois, harmonieusement.