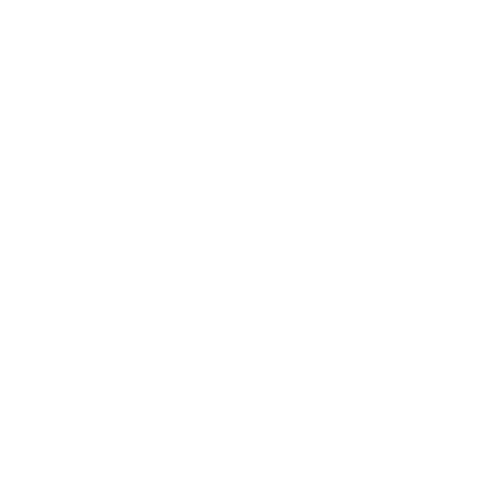Ghizlane Cherfeddine
Étudiante à la maîtrise en études cinématographiques
Bahia
Il y a des terres pétries de malheurs où on apprend aux enfants qu’il y a des temps de paix et des temps de guerres et que, entre les batailles, il y a la quête du paradis et de menues joies, des tombes à fleurir et des bébés à mettre au monde. Entre les temps de paix et les temps de guerres, il y a de petits bonheurs et de grands deuils, il y a la vie et il y a la mer.
Durant mon enfance et jusqu’à ce que la guerre civile éclate, nous passions toutes nos vacances en camping, au bord de la Méditerranée. Ces étés d’avant la terreur et ces rendez-vous avec la grande bleue, ce sont des délices que seules nos plus jeunes années peuvent nous faire connaître. Rêveuse, j’avalais la mer à pleine bouche, sans jamais reprendre mon souffle, et je me plaisais à l’imaginer me conter des récits merveilleux entendus sur d’autres rives. Aujourd’hui encore je l’ai dans la peau, cette mer qui me coule dans les veines.
L’été de mes sept ans, mes parents avaient décidé de planter nos piquets près du village de pêcheurs où mon grand-père était né et avait vécu avant de partir pour la capitale. C’était un hameau formé de petites maisons carrées, posées ici et là sur le flanc d’une colline qui descendait en cascade jusqu’à la mer. Une dizaine d’années plus tôt, un séisme avait vidé les modestes maisons chaulées de leurs habitants aussi vite que se seraient enfuies les fourmis d’une fourmilière dans laquelle on aurait donné un coup de pied. N’étaient restées dans les carcasses aux murs fendus que quelques familles de pêcheurs qui prenaient soin d’une poignée d’aînés esseulés, qui veillaient à leur tour sur les fantômes de ceux qui avaient disparu. Les pauvres vieux refusaient de quitter les murs cannelés, dont les zébrures se confondaient avec les sillons de leurs faces cuites de tristesse, pour errer entre les ruines et les tombes et y faire résonner des prières tremblotantes et essoufflées.
L’oncle de mon père était le seul membre de la famille qui habitait encore ce village fantôme, où les morts étaient plus nombreux que les vivants et, pour moi, ce pêcheur et son vaisseau avaient quelque chose de magique et de merveilleux. Petite fille, j’étais persuadée qu’un jour nous nous embarquerions ensemble dans un très long voyage qui nous mènerait sur toutes les mers du monde. Nous irions voguer sur les traces de Sinbad le marin pour chasser des oiseaux rokhs et rencontrer le roi de Serendip, et si nous ne réussissions pas à ramasser assez d’ambre gris, nous nous tournerions vers la piraterie, et peut-être même deviendrions-nous corsaires pour Barberousse et ses frères. À la fin du périple et à défaut d’un coffre rempli d’or et de rubis, nous ramènerions, dans nos filets, des orques, des baleines et peut-être même une ou deux sirènes.
Avec mon grand-oncle, je me rêvais matelot et capitaine, j’étais sa complice et me pensais son égale. À ce titre, je croyais devoir le seconder dans toutes les étapes qui suivaient son retour de pêche, ce qui ne manquait pas d’amuser mes aînés. D’abord, les cageots de sardines devaient être chargés dans le Peugeot 404 que mon cousin conduisait à destination de la ville où il était attendu par des restaurateurs impatients, des enfants équipés de paniers percés et une horde de chats errants, espérant recevoir l’aumône. Nous faisions ensuite le tour du village pour livrer à ceux qui n’avaient plus la force de pêcher ce que leur estomac leur réclamait et ce que leurs bourses pouvaient leur permettre. Nos chemins ne se séparaient qu’à la porte, toujours grande ouverte, d’Aisha, chez qui mon oncle déposait les filets à raccommoder et récupérait le pain qu’il distribuait aux aînés du village depuis la fermeture de la boulangerie.
Après avoir monté les trois marches grises, je soulevais le rideau, enlevais mes chaussures et me faufilais à l’intérieur de cette maison où j’étais toujours la bienvenue. Aisha me passait une serviette gorgée d’eau glacée sur le visage avant de s’en servir pour me frotter les pieds, puis elle soulevait le rideau entre le salon et le patio central et m’accompagnait jusqu’au bassin turc pour m’y laver les mains.
Pendant que j’étendais, pour les refroidir, mes orteils en éventail sur le sol carrelé et fraichement lavé, Aisha déposait des galettes de pain de semoule encore chaudes dans un grand torchon carré dont elle repliait les coins avant de les nouer. Je portais ensuite le paquet tiède et moelleux, au parfum d’anis et de nigelle, à l’entrée où m’attendait mon grand-oncle. J’étais impatiente de le voir partir pour courir retrouver la fille d’Aisha.
La petite cuisine bleue, fief et royaume de Bahia, étincelait de propreté, et malgré les arabesques que les secousses avaient dessinées sur le plafond et les portions de mortier révélé par la faïence qui avait sauté des murs, cette pièce recelait un charme que je ne savais expliquer. Je me souviens encore de la complexité des traits azurs et célestes de la céramique de Nabeul qui habillait les murs comme une fine broderie, du brillant des ustensiles de cuivre polis, soigneusement rangés dans des boiseries vernies et des veines, vanille et caramel, du plan de travail en marbre de Mahouna.
Agenouillée sur une natte de jonc vert, le dos courbé au-dessus d’un immense plat en terre cuite, la jeune femme pétrissait plusieurs kilos de pâte, la roulant avec un bras et la déroulant de l’autre, en un mouvement répétitif dans lequel elle mettait toute la puissance de son petit corps. Cette gymnastique était rythmée par la voix de la grande Warda, qui s’échappait d’un vieux combiné radiocassette, et par les chants d’Abdou, le chardonneret élégant, qui tentait de concurrencer la diva. Je me disais qu’il devait être là, le secret des délicieux beignets que Bahia confiait au jeune vendeur ambulant que des vacanciers ivres de soleil pourchassaient tout l’été, sur la grande plage de sable, à plusieurs kilomètres du village.
Anticipant ma visite, la jeune femme me gardait toujours au moins un beignet, qu’elle réchauffait sur le tajine de la cuisine avant de le fourrer avec de la confiture d’abricots et de l’habiller de cristaux de sucre. Le visage collant et barbouillé de pulpe de fruits, je dégustais ma friandise en fixant avec curiosité la pâte blanche et vibrante à laquelle ces mains savantes avaient donné vie pour que la chaleur puisse y faire des bulles.
Je la revois, mon amie Bahia, accoudée à son plan de travail pour rembobiner une cassette dont la bande usée avait été avalée par le lecteur, la faisant tournoyer sur la pointe d’un stylo, puis se retournant vers moi une fois le miracle accompli pour m’offrir un sourire sans pareil.
Quand les premières notes commençaient à crépiter dans les enceintes métalliques, elle appelait sa mère d’un joyeux « ’Yemma », avant d’enlever son tablier de travail au motif vichy rouge et blanc et de remonter sa jebba en la coinçant dans l’élastique de ses dessous, de chaque côté de ses hanches. Dès qu’Aisha apparaissait sur le pas de la porte, sa fille se trémoussait au son de la musique et se glissait jusqu’à elle pour lui prendre les mains et la faire danser. Prétextant les tâches domestiques qui l’attendaient, Aisha résistait toujours au début avant de s’abandonner et de rire aux éclats avec sa fille.
Un jour, sur le chemin du retour, j’avais demandé à mon grand-oncle pourquoi nous n’apportions jamais de poissons dans cette maison. Il m’avait répondu qu’Aisha et sa fille étaient les deux seules personnes du village qui ne mangeaient jamais de poisson. Quand j’avais voulu en savoir plus, mon oncle avait pris un air que je ne lui avais jamais vu en me répondant que c’était à cause de la guerre. J’ai alors deviné que je ne devais plus poser de questions. Cette guerre-là était partout, dans les livres, à l’école, à la télévision, mais ceux qui l’avaient vécue préféraient ne pas en parler. La réponse à ma question, je l’obtiendrais quelque temps plus tard, lors d’une journée dont je n’ai oublié aucun détail.
C’était l’aube et le soleil naissant infusait une lumière chaude et safranée sur la tente en toile de coton dont le vert flamboyait pour se transformer en un smaragdin vif et réconfortant. Encore couchée, je fixais la poussière d’or qui pénétrait l’étoffe en une multitude de rayons lumineux, là où l’usure et le temps avaient déjà fait leurs œuvres, pour venir se suspendre et danser au-dessus de moi. Autour, tout le monde dormait. Seule une personne manquait à l’appel.
J’ai délicatement enroulé le haut de l’épaisse couverture que je partageais avec ma sœur et je l’ai repoussée avec le plus grand soin pour m’extirper de ma couchette et me mettre debout sur le petit matelas de mousse posé à même le sol. Engourdie, chancelante, j’ai vacillé et failli tomber sur mon petit frère. Avant de sortir, j’ai pris le gros pull de papa qui, une fois enfilé, me couvrait cuisses et genoux, et je me suis débarrassée des grosses chaussettes que je portais la nuit en les roulant en boule et en les jetant sur la tête de ma sœur qui ronflait sereinement.
Une fois à l’extérieur, j’ai attrapé mes sandales Méduse et j’ai emprunté un petit chemin dont la pente laissait apparaitre une mer de velours qui venait s’échouer sur une petite plage de galets. Ma mère, confortablement emmitouflée dans une vieille liseuse en laine, était installée à quelques pas du rivage. Plongée dans un gros livre gonflé d’humidité, maman tournait une page jaunie, au coin corné, avant de remettre en place une mèche jalouse venue captiver son regard pour la priver de sa lecture.
Impatiente de la retrouver, j’ai dévalé la pente à toute vitesse avant de m’arrêter brusquement et de m’asseoir par terre pour nouer à mes pieds les chaussures de plastique transparent que j’abhorrais mais sans lesquelles je n’avais pas le droit de faire un pas sur le sol hasardeux de notre plage. Affalée sur le sol humide et bosselé, je me plaisais à imaginer que le tapis de galets luisants qui s’étendait autour de moi était un buffet garni d’un millier de beignets imparfaits, mais aussi savoureux que celui qu’il me tardait de déguster, et qu’il me suffirait d’en toucher un pour le voir déborder de sucre et de confiture.
Dès que je suis arrivée près d’elle, ma mère a déposé son livre pour retrousser mes manches pendantes en souriant devant ma drôle de tenue, avant de chasser les mèches de cheveux rebelles qui avaient frisé en boucles anglaises durant la nuit et qui collaient à mes joues roses et rebondies. Elle m’a regardé partir à la rencontre de la mer, comme je le faisais chaque jour, comme on le ferait pour la première fois. Elle aussi venait à peine de se réveiller et s’étirait en déployant des vaguelettes qui faisaient rouler les galets dans un cliquetis de jeux d’osselets. Les vagues avalaient les pierres polies qui en ressortaient propres et lustrées comme autant de joyaux illuminés par les rayons de l’aube.
Seule au bord de l’eau, je pandiculais, croquant la vapeur salée de cette mer qui ondoyait jusqu’à moi et me courtisait en léchant le bout de mes orteils, laissant les flaveurs iodées rompre le jeûne de la nuit. Ma mère a repris son livre et je me suis mise à rassembler tesselles et verre de mer pour composer une mosaïque éphémère, un puzzle éclaté de zelliges colorés. De temps à autre, je tournais la tête en direction de l’eau pour épier les bateaux de pêche qui commençaient à rejoindre la côte, chargés des prodigalités de la grande bleue.
Une large chaloupe à moteur, dont le bleu cobalt s’était écaillé en une multitude de taches de rousseur, s’avançait vers le rivage en ravivant mon enthousiasme. J’abandonnai alors ma composition pour courir au-devant du petit bateau, mais l’homme grisonnant et replet auquel j’adressais mon sourire ne semblait pas remarquer ma présence. Mon grand-oncle caressait sa longue barbe et fixait la plage d’un air absent tandis que son fils et unique matelot soulevait de la cale ce qui avait l’air d’un énorme poisson.
Après un instant d’hésitation, je me suis remise à avancer en direction du bateau, mais, cette fois-ci, mes pas étaient moins rapides et plus prudents. Je ne voulais désobéir à aucune règle et, comme tout bon mousse, j’attendais d’en avoir la permission pour approcher. Cachée derrière les rochers qui bordaient la crique, j’ouvrais grand les yeux pour observer l’amarrage du vaisseau et admirer le produit de cette pêche miraculeuse.
Médusée, j’ai vu mon cousin sauter du bateau avec, dans ses bras, le corps d’une jeune femme endormie qu’il a déposé délicatement sur la plage encore déserte. Je me suis approchée, hypnotisée par cette forme inerte, allongée à quelques pas de moi. J’avais compris qu’il ne s’agissait pas d’un poisson. Ce que je voyais, c’était le corps sans vie d’une jeune femme au regard vitreux et au teint blafard qui contrastait violemment avec le jais de sa longue chevelure. À quelques pas de moi, c’était un cadavre que je voyais et cette fille que je ne voulais pas reconnaitre, c’était Bahia.
Avant que quiconque ne puisse me remarquer ou me retenir, j’ai reculé et je suis rapidement revenue sur mes pas, sans larmes, sans mots, pour me réfugier dans les bras de ma liseuse. J’essayais d’échapper à l’horreur, aussi vainement qu’on essaye d’échapper à ces vagues furtives et malveillantes qui s’invitent parfois sur nos jolis bords de mer. Ces rouleaux perfides, qui viennent nous cueillir au sortir de l’eau pour se jouer de nous, nous aspirer vers les profondeurs et nous faire boire la tasse. Le monde des adultes m’avait captivée avant de me renvoyer au sein de ma mère, comme un violent ressac qui m’aurait recrachée sur la plage, échevelée, ensablée et suppliante, confessant ma petitesse et vomissant mon innocence, le souffle saccadé, brisé par cette baille qui me retournait l’estomac.
Jusque-là, ma mer était belle, joyeuse et généreuse, abondante de fruits et de vie. Était-il possible qu’elle soit capable de charrier la mort et le malheur ?
Dans mon enfance, depuis toujours, la mort était partout, mais elle n’avait jamais été assez proche pour que je la comprenne, ni jamais assez cruelle pour que je la craigne. Jusque-là, la mort était une abstraction que j’associais à ces inconnus qui peuplaient notre collection de photos argentiques, ainsi qu’à tous ces absents, partout présents, soigneusement encadrés, trônant sur les murs et sur les buffets de toutes les maisons, et dont on dépoussiérait les visages vitrifiés en même temps que les meubles et les boiseries qui les portaient.
Les morts, c’était les autres. Le grand-père d’une camarade de classe, la mère d’une voisine, des dizaines de combattants dont le courage débordait de nos livres d’histoire et des anonymes qui formaient des tranchées entre les allées du cimetière, avant que le poids des pierres ne vienne tout aplanir et que les dalles des tombes ne les fassent disparaitre sous terre.
Bahia aussi venait de disparaitre sous terre. Ma mer l’avait rendue, mais la terre l’avait reprise quelques heures après qu’on l’a sortie de l’eau. L’après-midi même, ma mère et ma sœur avaient rejoint les femmes du village pour préparer et servir les repas dans la maison de la morte tandis que mon père nous conduisait à la grande plage de sable, mon petit frère et moi, pour changer de décor et me changer les idées. Mais cette plage que j’aimais tant avait perdu tous ses attraits. C’était bien la première fois que je retrouvais la mer joyeuse et grouillante des après-midis de juillet sans m’y précipiter en faisant voler chaussures et vêtements pour y plonger la tête la première.
Tout semblait pareil, mais tout était différent. La mort s’était invitée dans mes vacances. Bahia n’était plus, pas plus que le jeune vendeur à qui elle confiait ses beignets et qui arpentait ces dunes de sable, de long en large, suivi de près par le vendeur de thé qui arrosait les vacanciers d’un jus mousseux et mentholé qui avait le pouvoir de dissoudre les sucres des pâtisseries, de sorte qu’on en redemandait encore et encore. Je ne pouvais que me sentir désolée pour tous ces heureux imbéciles, qui s’amusaient autour de moi sans se rendre compte de ce que leur monde venait de perdre.
Refusant de me baigner, je restai seule sous le grand parasol à franges, fixant mes orteils qui s’enfonçaient dans le sable brûlant pour chasser un petit scarabée noir qui persistait à vouloir y grimper avant de m’abandonner à son tour pour se terrer dans des galeries qui s’effondraient après son passage. J’avais beau y penser, je ne pouvais croire que mon amie était morte et enterrée et qu’elle était, elle aussi, une de ces silhouettes qui faisaient renfler les sols des cimetières et gonfler la terre fraîche d’une tombe qui ne portait pas encore son nom.
Une fois douchés et changés, nous avons rejoint tous les trois le flot de villageois qui serpentait les ruelles jusqu’à la maison d’Aisha. Tout autour, des tables et des chaises avaient été installées pour les trois prochains jours et de jeunes hommes faisaient des allers-retours entre les maisons alentour pour couvrir les nappes blanches de vaisselle, de paniers à pain et de bouteilles de limonade multicolore.
Les plus âgés, eux, avaient pris place autour de la table des desserts qu’on avait garnie de toutes sortes de fruits d’été qu’ils s’étaient donné pour mission de protéger des insectes prédateurs. Les ainés ainsi rassemblés suivaient le ballet des plus jeunes en secouant leurs éventails tressés au-dessus de la pulpe écarlate des pastèques, des melons canaris tranchés en croissant de lune et des raisins muscats et des sultanines dont les grains rouges et blancs, gorgés de jus, semblaient vouloir exploser.
Au bout de la table, juste à côté d’un plat de nèfles, quelqu’un avait déposé une cagette d’abricots. Des abricots. Bahia. La vue de ces fruits charnus, habillés de satin orangé, m’avait immédiatement ramenée aux beignets, à la confiture et à la gourmandise de Bahia qui ne pouvait s’empêcher de croquer dans ces fruits duveteux chaque fois qu’elle préparait ses garnitures.
On commençait à allumer les guirlandes lumineuses qui pendaient de toit en toit et la rue a pris les allures de la fête dont elle se serait parée si on avait voulu marier Bahia. On aurait presque pu y croire sans les mines défaites et fatiguées de ceux qui venaient d’enterrer l’une des plus jolies jeunes femmes de la région.
Avant de rejoindre les autres enfants, je me suis faufilée jusqu’à la petite cuisine bleue, espérant peut-être y trouver mon amie ou me consoler avec ce qui aurait pu rester d’elle, mais Bahia n’était pas là et Abdou non plus. La cuisine grouillait d’étrangères qui s’affairaient dans tous les coins, sous une vapeur dense et étouffante, qui effaçait à tout jamais les traces de mon amie.
J’étais debout, sur le pas de la porte, fixant avec horreur une femme qui avait osé porter le tablier en toile de coton vichy, rouge et blanc, quand ma grande sœur m’a attrapée par les épaules pour m’ordonner d’aller m’installer à la table des enfants avec mon frère et de m’assurer qu’il mange bien toute son assiette. Ma sœur n’avait que quelques années de plus que moi, mais pour elle je n’étais encore qu’une enfant, alors qu’elle appartenait depuis longtemps à l’élite des adultes, et même si son rappel à l’ordre m’a exaspérée, j’ai décidé d’obéir sans rechigner. Pour la première fois, l’enfant du milieu n’avait pas la force de résister.
Je regardai mon frère manger sans toucher à ma cuillère. Les deux petites filles à mes côtés essayaient de faire connaissance, mais je gardais les lèvres scellées par peur de laisser échapper le cri de colère qui grondait en moi. Sans doute lasses de mes mauvaises manières, elles se mirent à parler de Bahia, d’Aisha et du martyr, renchérissant sur les détails d’une vieille histoire que les villageois évoquaient parfois à la vue des deux femmes.
Tous les villages se souviennent des batailles de leurs héros et font les récits de leurs combats. On embellit le présent des plus jeunes, en leur transmettant les histoires et les victoires du passé pour que personne n’oublie les sacrifiés et que tous se souviennent du prix de la paix et de celui de la guerre. Tout le village connaissait l’histoire du martyr. C’était une histoire aussi vieille que Bahia, que les parents racontaient à leurs enfants pour les décourager de s’éloigner du rivage et de nager vers le large, là où des eaux plus sombres cachaient, dans leurs profondeurs, des os enchaînés.
C’est ainsi que j’ai appris que le mari d’Aisha avait disparu durant la guerre, alors que Bahia s’enracinait à peine pour grandir en elle. Torturé, les pieds emprisonnés dans un bloc de ciment, cet homme dont je ne connaissais pas le nom avait été poussé encore vivant d’un hélicoptère qui survolait ma mer, cette même mer dont Aisha et sa fille refusaient les fruits et dans laquelle elles ne se baignaient jamais.