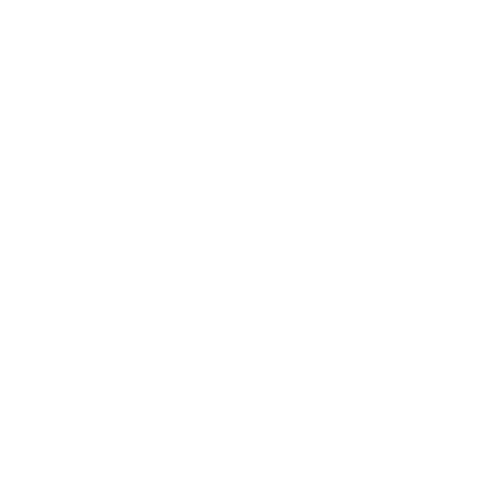Benjamin Forget
Étudiant à la maîtrise en recherche-création
(R)attraper le temps
Je reviens ici après tellement d’années. Ce n’est pas vraiment revenir, puisqu’« ici » n’a plus rien à voir avec ce lieu que je connaissais : un espace autrefois familier qui s’est transformé au fil du temps jusqu’à ne me laisser qu’un sentiment d’étrangeté, un malaise causé par l’écart entre ma mémoire et le réel.
« Faut pas exagérer quand même ! Les maisons sont pareilles… ou presque : y’a celle à Raphaël qui se ressemble plus pantoute. As-tu vu ça, Émile ? Y’ont tout pavé l’contour de la maison que son père a construite ! Criss, c’est rendu haute classe moyenne bourge icitte ! »
Je suis venu avec Jonathan, mon frère aîné qui pense s’acheter une propriété dans ce village où nous avons grandi. Nous n’avons pu nous empêcher de passer par notre vieux chez-nous, l’ancienne maison de notre mère qui, en son temps marquait la fin de la rue et le début de la forêt. Aujourd’hui, cette rue en croise une semblable, qui en croise, elle aussi, une autre, et cette dernière en croise probablement une autre. J’ignore où ça s’arrête. Dans mes souvenirs, le chemin débouchait sur des trails de quatre-roues que nous parcourions avec nos vélos de montagne, théâtre des aventures pas possibles que nous nous inventions. Maintenant, c’est une rue de banlieue comme les autres, dans un quartier de banlieue comme les autres. Il n’y a plus de trails et, d’ailleurs, il n’y a plus de forêt où les tracer. Il reste juste un nombre raisonnable d’arbres, comme pour ne pas trahir les cabanes qu’on construisait dans les cours. Le travail d’urbanisme et d’uniformisation qui s’entamait dans ma jeunesse n’a fait que s’accélérer : il y a des clôtures et des haies de cèdres, le chemin de gravier a été asphalté – pas trop récemment à en juger par les craques et les nids de poule – et le grand étang, qui s’alimentait à des dizaines de petits ruisseaux sillonnant la forêt, a disparu sans laisser de trace.
« As-tu vu ça, Émile ? Y’ont asséché l’étang ! Ça parait même pu ! Y’aurait été icitte, non ? Esti, un parc pour enfants. Tu parles d’une connerie, pareil ! Me semble qu’y’a moyen d’avoir du fun sans fucking modules ! My god… ça donne un coup de vieux… on a passé tellement d’temps autour de c’t’étang-là ! Te souviens-tu de la fois où t’as scrapé notre pêche aux grenouilles ? »
Si je me souviens… Nous nous étions levés tôt et nous avions enfilé nos vêtements à toute vitesse. C’était un samedi ou un dimanche : tout le monde dormait lorsque nous avons quitté la maison avec notre chaudière. C’était presque l’été, mais l’école n’était pas encore finie, ce devait donc être la deuxième ou la troisième semaine de juin. Nous avions marché jusqu’au bout de la rue assez rapidement. J’étais allé cogner chez Raphaël, mais il devait être trop tôt et personne n’avait répondu. Je transportais la chaudière vide à l’aller, en sachant que mon frère, qui était plus fort, la transporterait pleine au retour.
« Ben non ! C’est moi qui transportais la chaudière, pour l’aller et le retour. Toi, tu courais n’importe où devant moi, tu sautais dans l’fossé pis tu marchais sur le terrain du monde. T’avais ramassé une branche pis tu fendais l’air comme si c’était une épée. Tu menais des charges imaginaires contre des ennemis qu’y’avait juste toi qui voyais au milieu de la rue. Moi, j’m’assurais qu’on avait les filets pis ce qui nous fallait… pis je checkais la rue aux deux secondes pour être sûr qu’y’avait pas d’char qui s’en venait. J’sais même pas si tu l’aurais vu arriver tellement t’étais dans ta bulle ! »
Une fois parvenu à l’étang, j’avais déposé la chaudière, enlevé mes sandales et je m’étais avancé dans l’eau jusqu’aux mollets ; vu la taille que j’avais, ce n’était pas très loin du bord. Jonathan, lui, ne se mouillait pas. Il était trop mature pour ça et il réussissait tout aussi bien sans avoir les deux pieds dans la vase. C’est comme ça que nous pêchions les grenouilles : nous attendions, sans bouger, de les voir sortir la tête. C’est alors que nous nous activions : d’un geste brusque, mais précis, les mains devant, nous nous élancions et agrippions les grenouilles par surprise. Nous réussissions à en attraper une sur trois à peu près. Cette fois-là, nous en avions attrapé une trentaine.
« Trente ? Ben voyons don’ ! T’avais huit ans, Émile ! Ta trentaine, c’était une dizaine pas plus. Pis tu dis n’importe quoi : je pêchais pas à mains nues, mais au filet, pis j’embarquais souvent dans l’étang avec toi ! Sauf que maman s’fâchait quand j’salissais mon linge. Toi, vu que t’étais jeune, elle trouvait ça “normal”. Cette fois-là, on s’était pognés toi pis moi, à cause que t’arrêtais pas de grouiller dans l’eau pis j’te disais que tu faisais peur aux grenouilles. »
Ça avait été une pêche vraiment agréable : nous en étions revenus avec nos petits amphibiens bien calés dans la chaudière. Ça aurait été parfait si ça s’était arrêté là, mais j’étais trop curieux, trop impatient, tellement fier : j’avais tellement envie de voir les grenouilles. J’avais demandé à Jonathan si je pouvais regarder. Il m’avait répondu : « OK, mais fais attention. » Alors je m’étais élancé, les mains devant, j’avais agrippé le couvercle et l’avais ouvert. Tout s’est alors passé très vite : la chaudière est tombée, l’eau a coulé, les grenouilles ont fui et, moi, je me suis mis à pleurer. Après un instant, Jonathan avait redressé la chaudière ; moi, je m’étais ressaisi et j’avais tenté d’attraper les grenouilles en fuite dans le fossé, sans grand succès. Nous étions loin de l’étang. Elles ne survivraient sûrement pas, mais il fallait que nous repartions. Discrètement, j’avais recommencé à pleurer : je savais que mon impatience venait de coûter la vie à ces petites créatures.
« Tu m’as rien demandé, j’te le jure ! Ça m’a surpris quand tu t’es garroché sur la chaudière, c’est pour ça que je l’ai échappée ! Pis du moment qu’elle est tombée, toi, t’as figé ben raide, pis tu t’es mis à brailler. J’ai redressé la chaudière, tu t’es assis dessus pis je t’ai flatté le dos jusqu’à ce que t’arrêtes de pleurer. »
Le reste du chemin vers la maison a pris des allures de cortège funèbre : Jonathan portait le cercueil et, moi, j’étais la pleureuse. Des corbeaux croassaient. Le soleil radieux, le vent léger et la forêt chantante semblaient se moquer de moi tellement ils détonnaient avec mon état d’esprit. Un voisin, trop matinal à mon goût, passait la tondeuse : il nous avait envoyé la main, mon frère lui a discrètement répondu alors que nous continuions de marcher en silence, la tête basse, mon frère devant et moi derrière.
« Martin pis sa tondeuse… J’m’en rappelais pu de lui ! Maman chialait tout l’temps que ça avait pas d’allure de passer la tondeuse à huit heures du matin. J’me demande si y’habite encore là, le bonhomme ? Ça m’étonnerait pas, parce que le gazon devant la maison est encore bien trimé ! »
Arrivés dans la cour, où nous avions creusé la veille un grand trou, nous avons déposé les trois grenouilles qui nous restaient, sans échanger un mot. Celles-ci se sont empressées de bondir dans le saladier en plastique rempli d’eau que nous avions installé. Dans ce trou, nous avions aussi deux crapauds. Il devait être à peine neuf heures et nous étions déjà épuisés : ça se lisait sur nos visages. J’avais les yeux rougis et gonflés, le bas du nez irrité à force de le frotter avec mes manches ; Jonathan, qui n’avait rien trouvé pour me calmer, demeurait silencieux, probablement pour ne pas me contrarier. Nous nous tenions debout à côté du trou, scrutant l’intérieur : peut-être à la recherche du plaisir que nous avions en commençant cette aventure, peut-être en train de réciter une eulogie silencieuse, ou – dans mon cas – en train d’imaginer comment l’histoire se serait déroulée si je n’avais pas été aussi impatient.
Les corbeaux croassaient toujours. Nous étions en deuil autour d’un trou que nous avions creusé nous-mêmes. Une grenouille coassait. Le soleil brillait, il n’y avait pas un nuage dans le ciel, mais il y avait la mort qui rôdait. J’avais le cœur coincé dans la gorge et je ravalais mes larmes de peine et de misère. Nous avions tous deux envisagé cette matinée tout autrement. À l’intérieur de la maison, des bruits se faisaient entendre : il serait bientôt temps d’aller déjeuner.
Aujourd’hui, ici, plus rien, dans cet espace, ne peut témoigner de ce drame. Ni la rue asphaltée, ni le parc, ni ces fossés qui sont maintenant des trottoirs ne portent la trace de ce qui m’a tant bouleversé autrefois.
« On sacre-tu notre camp d’icitte ? Je pense qu’y’a pu ce que je cherchais dans l’bout. J’achèterai à Saint-Jérôme, au pire. »